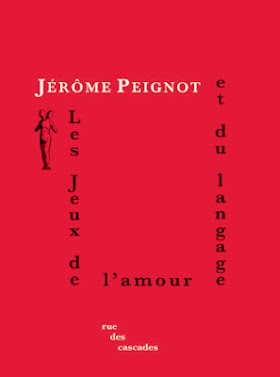Jérôme Peignot (né en 1926) est l'auteur d'une trentaine d'ouvrages qui
comprennent romans, pamphlets, nouvelles, essais, albums pour enfants... Il s'est
également fait connaître en participant à diverses actions politiques, en
publiant Les écrits de Laure, et en dirigeant un ouvrage important sur
la Typoésie (sur le sens de ce
mot, se reporter ici à l’article du magazine littéraire Le Matricule des anges) ainsi qu’une Histoire et art de l’écriture (en association avec Marcel Cohen).
Il est le fils de Charles Peignot, directeur de la fonderie Deberny et Peignot.
Jérôme Peignot découvre au Lycée Louis-le-Grand
les ravissements de la culture savante en même temps que la cruauté de la
guerre (il en parle abondamment dans ses nouvelles et sera décoré pour faits de
résistance). Bachelier en 1945, il s'inscrit en Sorbonne pour y obtenir un certificat
d’esthétique de la licence libre en 1946 et suit parallèlement la scolarité
de l'École Estienne, dont il sera diplômé. Engagé tôt en littérature, sous
l'influence de Michel Leiris en particulier, Jérôme Peignot publie en 1957 le
premier volume de ses Jérômiades suivi de deux autres (le tome
III obtiendra le prix Sainte-Beuve en 1962, mais l’ensemble est aujourd’hui
épuisé). Il travaille néanmoins dans l'édition, d’abord aux services de
fabrication puis en tant que lecteur et rédacteur. À partir de 1961, le monde
de la radio fait appel à lui. C’est un collaborateur régulier de l’émission Le
masque et la plume dont il est jusqu'en 1964 co-producteur et
co-réalisateur. Puis, de 1972 à 1983, il produit diverses émissions littéraires
et philosophiques pour France Culture : Les chemins de la connaissance, Les
nuits magnétiques, La matinée littéraire... Il apparaît également dans un
long-métrage de Michel Polac, La chute d'un corps. Enfin, entre 1981 et 1991, Jérôme
Peignot revient en Sorbonne pour se charger d'un cours sur l'écriture et la
typographie, après avoir obtenu en 1982 un doctorat d'État sur le sujet de la
calligraphie latine. Distingué Chevalier des arts et Lettres en 1984, Jérôme
Peignot a versé ses archives personnelles et manuscrits à la Bibliothèque de
l'Arsenal (Paris) en 2007.

Les jeux de l’amour et du langage, publié pour la première fois en 1974 dans la collection
10/18, réédité récemment par l’éditeur Rue
des Cascades, s’organise en 15 chapitres, débute par un Petit traité de l’androgyne et se
termine par un essai sur Georges Bataille, au sujet du pouvoir érotique des
mots qui conduit à traverser ou crever, non sans risque, "le mur
du sens". Dans le chapitre III, "Le cri silencieux de l'extase tantrique", l'auteur rappelle la situation de crise annoncée depuis longtemps par le philosophe René Guénon :
Dans
son ouvrage intitulé La crise du monde
moderne, René Guénon démontre avec un luxe de détails à quel point il est
évident que nous nous trouvons dans cette dernière période dite du Kali-Yuga au terme de laquelle le monde
doit s’enfoncer dans la nuit. « Le monde moderne, écrit-il, ira-t-il jusqu’au
bas de cette pente fatale ou bien, comme il est arrivé à la décadence du monde
gréco-romain, un nouveau redressement se produira-t-il cette fois encore avant
que le monde n’ait atteint le fond de l’abîme où il est entraîné ? Il
semble bien qu’un arrêt à mi-chemin ne soit plus guère possible et que, d’après
toutes les indications fournies par les doctrines traditionnelles, nous soyons
entrés vraiment dans la phase finale du Kali-Yuga,
dans la période la plus sombre de cet âge sombre, dans cet état de dissolution
dont il n’est plus possible de sortir que par un cataclysme, car ce n’est plus
un simple redressement qui est nécessaire, mais une rénovation totale. »
Jérôme Peignot écrit à la suite de
ce long extrait :
Il nous
reste donc peu de chances de nous en sortir. Si, néanmoins, nous voulons nous
extraire de ce mouvement dans lequel nous sommes pris, il nous faut commencer
par le commencement, c’est-à-dire par réviser notre manière de considérer
l’amour.
Peu d’ouvrages nous parlent ainsi d’une redéfinition
de l’amour (mais peut-être que la période d’écriture de cet ouvrage s’y prêtait
plus favorablement) et des rapports qu’il entretient avec le
langage, ses équivoques, ses impasses, ses plaisirs... En chemin, de page en
page, Jérôme Peignot rappelle des évidences, nous reconduit en toute (fausse) simplicité
à l’essentiel :
L’art
n’est qu’un prolongement du sentiment amoureux.
Les mandalas nous font parfaitement saisir
que l’amour est l’occasion par excellence de voir s’abolir les contraires.
Dans le chapitre IV, Le roman vrai de Tristan et Iseut ou De la
fable à la légende :
Il
n’est pas d’amour qui ne soit une diffraction, une déviation. L’amour n’est pas
dans les mots mais entre les mots.
Passant de la Quête du Graal à l’art
d’aimer des troubadours, Peignot aborde les gnostiques :
Un
gnostique n’a pas la foi, il connaît et, comme il « connaît » ce
qu’il importe de savoir par l’entremise de l’amour de la femme qui détient la
Sophia, il vit sa « Connaissance » plutôt qu’il ne l’acquiert. Ainsi
pour un gnostique, « aimer » signifie « comprendre ». De
fait, existe-t-il une forme de connaissance plus accomplie que l’amour ?
Dans les chapitre suivants, l'auteur continue de s'interroger sur les interactions de l'amour sur le langage, s’intéresse à
la secte des Adamites (et au Royaume
millénaire de Jérôme Bosch), au langage des sorcières, à la Kabbale, aux
aphorismes de William Blake, au "langage blanc" d’Hypérion du poète
Hölderlin, à la "re-création" du langage Fouriériste, à l’écriture
surréaliste :
C’est
que, lui aussi, l’argot procède par périphrases et il est souvent parfaitement
séant, évoquant l’amour et ses plaisirs, d’emprunter ces chemins de traverse.
Les mots ont leur part de responsabilité dans les « égarements » tant
de « l’esprit » que du « cœur ».
Citant André Breton, dans ce même
chapitre :
"Et
qu’on comprenne bien que nous disons jeux de mots quand ce sont nos plus sûres
raisons d’être qui sont en jeu. Les mots, du reste, ont fini de jouer :
les mots font l’amour"
Enfin, dans le chapitre XV qui clôt
cet ouvrage, où il fait référence à Georges Bataille ainsi qu’à Sade, citons ce
dernier extrait :
L’essentiel
de la transe érotique se vit dans l’imaginaire, la pratique n’étant jamais qu’à
la traîne d’une imagination phare. En ce sens, l’érotisme n’est autre que
l’imagination réduite à sa plus simple expression et sous sa forme la plus
déliée. Mais il n’est possible de faire montre de cette
« imagination », dans tout ce qu’elle implique, qu’amoureux. L’amour
est l’érotisme. C’est lui qui confère à l’érotisme son caractère de transe.
Une autre video de Jérôme Peignot est visible sur Dailymotion